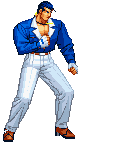Les années 'Yéyé' : Jean-Lucien Miksa
Jean-Lucien Miksa nous raconte ses souvenirs des années 60 :
A 14 ans à Behren-cité, j’avais quelques bons copains et c’est à contre cœur que je les quittais car ma mère ne supportait plus de vivre dans un immeuble collectif. C’est ainsi que nous avons dû déménager pour la vieille cité du Habsterdick sur la commune de Stiring-Wendel.
Mes frères un peu plus âgés que moi y ont retrouvé des copains de colonie de vacance et moi j’ai pu faire la connaissance, après une petite bagarre sur la place du marché, de jeunes de mon âge qui sont devenus mes copains, ou potes comme on disait alors. Nous nous donnions rendez-vous dans la cave de l’un d’eux, Sylvain, pour y écouter de la musique « YéYé ». C’était le temps des Johnny, Eddy Mitchel et autres rockers dont on écoutait, sagement assis sur tout ce qui pouvait faire office de chaise, les disques que ceux qui avaient un peu d’argent de poche achetaient.
Le son était toujours très fort et pour se parler il fallait hurler. Beaucoup d’entre nous fumaient déjà et la bière circulait de l’un à l’autre. Curieusement il n’y avait pas de filles, pourtant presque tous avaient une copine, bien sûr sauf moi, le petit dernier arrivé parmi eux par hasard.
C’étaient les années d’insouciance et le plaisir de se retrouver était partagé. Deux ou trois soirs dans la semaine nous étions ainsi dans cette cave, bien au frais en été, mais très au froid en hiver. Qu’importe le temps qu’il faisait, nous étions toujours à l’affût de la dernière chanson du hit-parade que nous allions pouvoir écouter en « vrai » et non par le haut-parleur des transistors. Ces derniers ne restituait que très pauvrement cette musique enivrante. Dans notre « club », grâce à un petit tourne-disque et son haut-parleur de qualité, nous pouvions savourer cette musique et chanter à tue-tête les paroles que chacun se devait de connaître par cœur.
Certains soirs nous allions nous promener ensemble avec les copines qu’avaient mes potes. Nous allions aussi à la piscine de Sarrebruck en Sarre. Le groupe que nous formions était très soudé et le lien qui nous unissait était cette musique qui nous emballait et dont les paroles d’amour ou de détresse pouvaient correspondre à ce que nous vivions ou attendions de la vie.
L’amour de cette musique allait si loin que la plupart d’entre nous cherchaient à former un « vrai » groupe de musiciens. Mes frères répétaient avec des amis et j’ai eu la chance de rencontrer un jeune de mon âge qui voulait monter un groupe lui aussi. J’étais heureux car il me promettait de me confier sa batterie, oui, j’allais devenir batteur… Ma déception fut grande lorsqu’il a disparu de ma vue. Je n’ai plus eu d’offres similaires et je me suis contenté d’écouter les productions des autres groupes.
Lorsque j’ai eu 16 ans, j’ai reçu pour la première fois de l’argent de poche de mon père. Il donnait chaque samedi 10 francs à mes frères et moi j’avais droit à 5 francs. Du moins officiellement devant mes frères, car dès qu’ils avaient tournés les talons mon père me rajoutait 5 francs. J’étais fier de mettre en poche ces deux beaux billets de Victor Hugo dans ma poche. Ils allaient me permettre de me payer l’entrée le dimanche après-midi au thé dansant du café « Le Métropole » à Stiring dans la rue à l’arrière de l’église.
Mais avant d’y aller il fallait prendre son bain le samedi soir dans la cave de la maison. C’était toujours la bagarre pour savoir qui serait le premier à prendre son bain. En effet l’eau chaude qui avait été portée à température dans une grande bassine sur un vieux fourneau à bois était versée dans une baignoire de récupération et n’était pas changée entre chaque individu. On ne faisait qu’en rajouter lorsqu’elle était trop froide. Ensuite j’avais le devoir de sécher les cheveux de mes frères et leur faire un brushing. L’aspect de la coupe des cheveux mi- longs que mon père nous autorisait à avoir était très important. Il fallait ressembler aux « idoles des jeunes ». Je me souviens des costumes, des blazers, des pantalons à ceinture espagnole, des pantalons de marins, ou des pattes d’éléphants que j’ai aimé porter.
Ainsi paré j’allais au « Métro » comme on disait. L’entrée était de 5 francs et on recevait un bon pour une boisson.
Dans cet endroit il n’y avait pas de groupes qui jouaient, mais c’était un disque jockey qui passait des chansons qui nous poussaient sur la piste de dance. C’était le plus souvent le fils du patron qui officiait à ce poste. L’ambiance était chaleureuse et j’y retrouvais tous mes amis. Malgré mon costume cravate, qui était une obligation à l’époque pour les jeunes fils de mineurs que nous étions, je n’avais pas beaucoup de succès auprès des jeunes filles qui préféraient des garçons un peu plus âgés. J’étais souvent frustré, mais cela ne m’empêchait pas de m’amuser et danser le twist en solo.
Certains dimanches furent entrecoupés de belles bagarres et je me souviens d’une de celles-ci tout particulièrement. Je prenais à l’époque des cours de karaté en Allemagne avec un ami mineur de fond et lorsque j’ai été provoqué par un jeune je n’ai pas pu éviter l’affrontement. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je devais sauver la face devant mes copains, alors je suis sorti me battre avec lui. Pendant notre bagarre, je ne portais aucun coup mais lui montrais mon savoir-faire de karatéka. Du moins jusqu’à ce qu’il ne m’attrape par la cravate et tente de m’étouffer. Là c’en était de trop et je lui ai administré quelques coups afin de me libérer de cette fâcheuse posture. Mais mon beau costume avait perdu de sa fraîcheur après cet échange un peu viril et j’appréhendais le regard de mon père.
J’ai attendu qu’il fasse nuit pour rentrer, mais mon père attendait… Dès qu’il vit mon costume et un peu de sang que je n’ai pas pu cacher il me demanda : t’es tu battu ? Je lui répondis oui et il rajouta : il était plus grand que toi ? Lorsque je lui dis qu’il me dépassait d’une tête, mon père prit une attitude plus clémente et me dit : alors ça va, je ne veux pas que tu te battes avec des plus petits que toi. Cette phrase est gravée dans ma tête pour toujours. J’étais content de n’avoir pas été sermonné plus que ça, et j’avais le sentiment qu’il était fier de savoir que je savais me défendre. La confiance en moi avait grandi et j’ai osé sortir un peu plus loin dans d’autres cafés dansants de Stiring. C’était chez Jager rue du général Grégoire et le café à la Rose rue Saint-Roch.
Et puis j’ai grandi un peu et j’ai eu le droit de suivre mes frères le dimanche à Forbach.
Là-bas nous allions au café de la poste qui avait sa salle de dance, le « caveau de la poste ».
Il était situé dans le sous-sol et il fallait sortir du café, passer par un passage sous les bâtiments pour accéder à la porte d’entrée située à l’arrière du bâtiment. Dans ce « caveau » de vrais groupes jouaient les tubes du hit-parade ainsi que des compositions personnelles. Cette musique était si entraînante qu’elle échauffait bien souvent les esprits et comme il était d’usage à l’époque, tout cela se terminait en de belles bagarres où la plupart du temps il ne restait à la fin que des amis. Nous fréquentions aussi un autre café de Forbach, le café des trois piques qui avait à l’étage une discothèque où se produisaient également des groupes de la région. Un autre café-pâtisserie, chez Dolisi, était fréquenté par des jeunes un peu plus âgés et je n’y suis allé qu’une ou deux fois. De temps en temps nous allions jusqu’à Freyming dans le café Witkowski où mes frères retrouvaient d’autres copains.
J’étais heureux de pouvoir vivre ces dimanches avec mes frères et leurs copains plus âgés que moi. Tous avaient une copine, excepté moi et il n’était pas question que j’en pique une à l’un ou à l’autre. Mais dans tous ces endroits j’étais trop jeune pour les filles.
Alors je dansais seul, j’en avais l’habitude et je me contentais de boire un coup avec cette bande.
Puis ce furent les sorties du samedi soir qui prirent le relais. Avec les copains de mes frères, dont certains avaient déjà une voiture, nous allions aux bords d’étangs de la région et faisions des sorties dans d’autres salles de dance.
L’une d’elles était la célèbre salle « Sommer » à Stiring où le même scénario du danseur en solo se jouait pour moi. Mais ici la musique des années YéYé était remisée au profit de la musique des bals populaires que chantait si bien Michel Sardou.
La célèbre salle Sommer qui a fait le bonheur de plusieurs générations de danseurs
Et moi, eh bien personne ne m’avait appris ni la valse, ni le tango, ni les autres danses qui forment des couples qui semblent partager des moments inoubliables. Comme je les enviais, moi qui ne dansait que le slow, et encore, quand une fille le voulait bien.
Voilà ce qui me reste comme souvenirs de ces années Yéyé, l’insouciance, l’amitié sans faille, des après-midi et soirées mémorables, quelques bagarres sans gravité et le sentiment d’avoir appartenu à une époque déjà presque oubliée...
Salut les Copains ! Jean-Lucien Miksa (JLM)
Ces années là...
Les années Yéyé ce n’étaient pas que la musique. C’était aussi les cheveux dans le vent. Et pour les avoir dans le vent le vélo ne suffisait pas. Il fallait une mob, une bécane quoi. Mais attention, une vrai, une qui fait du bruit. Une où on change les vitesses au guidon. Tous mes copains avaient la leur tandis que je désespérais d’en avoir une aussi.
Déjà lorsque j’habitais encore Behren-cité, un groupe s’était formé pour rouler ensemble. Je me souviens très bien qu’un groupe était descendu jusqu’à Marseille avec ces petits engins de moins de 50 cc3. C’étaient des Flandria, Zundap, Motobécane, customisées comme on dit aujourd’hui. Certaine bécanes avaient des guidons où il fallait lever les bras très haut pour piloter l’engin. Elles ressemblaient de loin à ces belles motos qu’avaient les Hells angels de Californie. Nos pilotes avaient même des blousons avec des franges et des aigles dessinés dans le dos. Il ne faisait pas bon de se frotter à eux… mais quand on était un de leurs potes, on pouvait compter sur eux en cas de coup dur.
Mais au Habsterdick il n’y avait pas de groupe comme à Behren. Il y avait par contre des surdoués de la mécanique. Des amoureux de la vitesse. J’enviais mes potes qui faisaient des courses dans les rues avec leur Kreidler ou Flandria avec de vrais changements de vitesse au guidon. Les pots d’échappement étaient souvent trafiqués pour faire le plus de bruit possible.
Ces pages devraient également vous intéresser :
Clément Keller : récits & souvenirs
La future place du souvenir des anciens de la Ferme
Clément Keller : le CD Anthologie
Schoeneck beau coin : autres récits
Alléluia ! Il marche et il parle...
Je vais ’recevoir’ une petite sœur
Opa Adolphe - Mon premier vélo
Autres pages locales
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 220 autres membres